« Renouer avec la mémoire » : histoire et identités dans le roman francophone (del Castillo, Yourcenar, Aquin & les autres)
Indice
Le sortilège espagnol : Manrique et Ana del Jesus
« Ana de Jésus, c’est moi ! » : Ana, « métaphore éloquente de mon destin »
« Les seules fleurs étaient les adelfas du cloître »
Abstract
Italiano | IngleseIn questo saggio vengono analizzati alcuni romanzi di scrittori francofoni (Aquin, Yourcenar) o di scrittori che, venus d’ailleurs come Michel Del Castillo, scelgono la lingua francese come lingua di scrittura. Si tratta per lo più di romanzi la cui azione si svolge nel XVI secolo e affrontano, filtrate dalla ricerca identitaria e dai meandri della memoria, tematiche storiche e religiose di grande impatto, come l’Inquisizione o lo sterminio dei Mori. Nei personaggi del Rinascimento gli scrittori contemporanei trovano un alter ego che permette loro di confrontare la Storia e la propria storia, in una dialettica tra memoria e oblio, in un dialogo incessante che permette loro di sondare le origini lontane della loro inquietudine e di capire se stessi e “l’altro che è in noi”.
Élie Wiesel (comme Semprun, Némirovsky, Levi…) revient plusieurs fois sur le fait que le témoignage est pour lui une tâche nécessaire, un devoir de mémoire, mais qu’il s’agit d’une épreuve vraiment chargée d’angoisse et à la limite du supportable :
Pourquoi j’écris ? Peut-être pour ne pas devenir fou. Ou, au contraire, pour toucher le fond de la folie.
Comme Samuel Beckett, le survivant s’exprime « en désespoir de cause » ; il écrit parce qu’il ne peut pas faire autrement. […]
Les mots me séparent de moi-même. Ils signifient absence. Et manques.
Comme métier, il y en a de plus faciles, de plus agréables sûrement. Mais, pour le survivant, écrire n’est pas un métier mais une obligation ; un devoir. […]
Sur une vingtaine de volumes, seuls trois ou quatre pénètrent dans le royaume fantasmagorique des morts. Dans les autres, par les autres, j’essaie de m’en éloigner. C’est qu’il est dangereux de s’attarder avec les morts ; ils vous retiennent et vous risquez de ne vous adresser qu’à eux.[…] Parfois, il me semble que je parle d’autre chose dans le seul but de taire l’essentiel : l’expérience vécue. […]
Pourquoi j’écris ? Pour les arracher à l’oubli. Et aider ainsi les morts à vaincre la mort.1
Chez Michel del Castillo, ce double visage de l’écriture est encore plus évident. Dans tous ses romans il réalise une décomposition des événements de sa vie, il essaie de trouver une explication et en même temps il cache à soi-même la vérité affreuse de cette mère-Médée qui l’a abandonné, ainsi que tous ses enfants, tous nés d’hommes différents, et de ce père inexistant, agacé et mesquin. Tous ses livres sont des variantes d’une même histoire dramatique, tous les personnages féminins sont les innombrables visages d’une mère fuyante, monstrueuse et à l’allure romanesque, tous les enfants protagonistes sont ses doubles, abandonnés et meurtris, à jamais, dans l’âme. Dans ses ouvrages la littérature et l’écriture sont sa seule raison de vie: dans une existence brisée et incompréhensible, les livres étaient le seul point de repère, ils lui ont permis de survivre :
La lecture était mon seul lieu de survie. Sans les livres je ne tenais pas debout. Imaginez ce que peut être la vie d’un enfant avec quelqu’un qui ment vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur tout, ses maris, ses amants, ses enfants abandonnés, son âge, ses identités. On est en plein romanesque et un enfant ne peut pas faire le partage. […] Et puis il y a cette situation historique incompréhensible. Qui sont les bons ? Qui sont les méchants ? […] Pour l’enfant personne n’est fiable. Alors, il reste aux contes qui donnent le blanc et le noir. […] Tous ces écrivains, Balzac, Dumas, m’ont pris par la main.2
Dans ces conditions, l’écriture prend la valeur du salut au sens existentiel, toutefois en même temps elle oblige à se souvenir, comme pour Semprun et Wiesel. Elle fait revivre les douleurs et les angoisses, en devenant aussi moteur d’un malaise :
Le jour où je cesserai de marcher, c’est-à-dire d’écrire, je mourrai tout à fait. Je sais tout ça depuis ma petite enfance. À quatre, cinq ans, j’avais compris que je devais parler mon angoisse pour rester en vie.
Contrairement à ce que tant de gens imaginent, l’écriture ne console de rien. Plus je fonce dans les mots, plus mon malheur se creuse. Chaque livre aggrave mon état. On finit par mourir, non de ce qu’on a vécu, mais de ce qu’on écrit.3 (De père français)
Le changement de langue se colore d’une dimension métaphysique, voire mystique, qui le transforme en “exercice d’ascèse”(Cioran) aux connotations douloureuses, mais qui se révèle souvent, au moins dans certains cas, parmi les plus connus - Cioran, Semprun, Ionesco, Beckett, Panaït Istrati, Kristof, Del Castillo -, en “camisole de force”, aux débordements lyriques, au pathos à l’état pur. Issues de l’expérience de l’exil volontaire (Cioran, Beckett, Makine...) - si on peut le définir ainsi - ou bien forcées par les contingences historiques ou/et politiques (Kristof, Ionesco, Kundera...)4, ces écritures “autres” se doublent souvent d’un apprentissage d’une langue, d’une recherche d’un langage, d’un style, qui comporte l’effort d’une “double traduction”, d’une langue à l’autre, du langage extérieur au langage intérieur5. Expériences d’une confrontation avec l’altérité, avec l’“estraneité” et le décentrement, avec le déracinement, le déplacement, la migration voire la marginalisation, ces écritures sont fortement connotées par la rupture identitaire, par cette descente au fond de l’enfer, expérience du choc ou du “supplice” identitaire qui les rend si modernes et si troublantes. Romans de la langue, du bilinguisme voire de la scission identitaire douloureuse, d’une division des mots et de l’âme (de ce qu’on appelle le double bind) qui remonte - pour Makine, pour Esteban mais, nous le verrons, encore plus douloureusement pour Michel del Castillo - à l’enfance “partagée” entre deux langues, deux cultures, un père et une mère “absents” et tragiquement cruels, voire mortels. L’enfance traumatisante est pour nombre de ces écrivains “déchirés” une source d’inspiration, un leitmotiv qui revient inlassablement comme un refrain triste pour remplir les vides d’un passé “contraignant”6. Ces personnages enfantins, solitaires, sauvages, dédoublés et dédoublants, deviennent les interprètes, les truchements des ces âmes errantes et exilées, de ces “destinées marginales” qu’ils métamorphosent en poésie de la douleur7.
Michel Del Castillo, né à Madrid en 1933, de mère espagnole, “de père français” (c’est le titre de son roman publié chez Fayard en 1998)8, a trouvé dans la langue française, dans l’écriture sa famille d’appartenance, la famille qu’il n’avait jamais pu avoir: “Je voyais la France derrière tout ce qui apporte une consolation au malheur de vivre”, écrit-il dans son flamboyant Le crime des pères, qui commence d’ailleurs par une déclaration de haine: “Je n’aime pas l’Espagne, je déteste les Espagnols”9. Si en commentant le livre d’Amin Maalouf, Identités meurtrières, Del Castillo affirme avec conviction, combien sincère on l’ignore, que ces problèmes ne l’ont jamais concerné : “J’ai choisi ma part française, j’ai choisi d’écrire en français, dès lors je me sens français, tranquillement, sans pour autant renier ce que je dois à l’Espagne” (p. 29), il écrit aussi, quelques pages après, “moi l’Espagnol un tantinet austère, d’un orgueil sombre” (p. 48).
Or, au-delà des déclarations de principe son œuvre démontre toute la complexité de son existence, de son passé contraignant marqué par le rapport avec sa mère: extraordinaire personnage aux mille noms et aux mille identités, révolutionnaire, anarchiste, antifranquiste, journaliste, écrivain, aventurière, libre, indépendante - six enfants, six pères différents, tous abandonnés, l’un après l’autre. Dénoncés, la mère et l’enfant, en 1940 par ce père français sous prétexte qu’ils “risquaient de compromettre [sa] situation chez Michelin à Clermont-Ferrand”10, déportés à Rieucros, Michel est abandonné en 1942 par sa mère qui réussit à s’enfuir à travers les Pyrénées. L’enfant, à neuf ans, est déporté en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre quand, vu que personne ne veut de lui, il est de nouveau interné dans un camp de redressement espagnol jusqu’en 1953, date de son départ pour la France. Il a 20 ans: « Je suis né pratiquement à vingt ans, ou plutôt je suis “rené”. Le rêve de toute ma vie, c’était de retrouver la France, alors, arriver à Paris ... j’en pleurais vraiment. J’ai pu me mettre à écrire. Et moi, je suis très bête, je suis patriote, j’adorais ce pays depuis ma petite enfance.»
Une enfance qui revient comme un cauchemar, hantée par le fantôme de cette Mère tant aimée et tant haïe, par cette Mère absente, marâtre et cruelle et pourtant toujours présente même dans son “choix de la part française”. Dina, l’un de ses noms, rentre en France après la guerre et meurt à Paris, rue des Archives, en 1993, dans la déchéance et l’abandon le plus total:
J’ai passé mon enfance à souhaiter intérieurement la mort de ma mère, c’est-à-dire en être délivré... Je ne devrais pas dire ça, mais c’est vraiment quelqu’un qui me répugne, c’était un monstre.11
C’est le sujet de l’un des romans les plus troublants de Del Castillo, Rue des Archives (1994), roman de la mort de cette mère- “Gorgone aux yeux implacables, majestueuse souveraine de l’ombre”, “puissance de destruction” qu’il “vénère en ... Kali sanguinaire” (p. 61). Une figure mythique qui semble se “jeter sous sa plume” et qui, écrit-il: “Ce n’est pas non plus ma mère, c’est un personnage” (p. 43). Michel, pour ne pas sombrer dans l’enfer, se crée un double enfantin, une sorte d’alter ego avec lequel il établit un dialogue qui, page après page, s’instaure, se fait plus profond, traverse les larmes et les sourires dans cet extraordinaire récit d’une mort et d’une morte: “Dans le TGV filant vers Paris, le narrateur observait son double, l’enfant” (p. 17). Son Xavier qui le suit comme un ange en costume marin, (p. 123) est Michel à neuf ans, l’enfant qui aurait voulu garder intact son souvenir de sa mère, que “vers l’âge de cinq ou six ans, il ... confondait avec la Reine de Blanche-Neige, plantée devant son miroir” (p. 17). Un double donc, qui diffère du double du XIXe siècle, un double issu, ici comme chez Kristof et les autres d’un double bind, d’une dualité linguistique et identitaire qui traduit un conflit passé et présent. Ce moi passé et ce moi présent, Xavier et Michel ne s’opposent pas, ils se nourrissent l’un de l’autre dans un dialogue bercé par la tendresse infinie qu’ils n’ont pas eue, pour s’aider. Michel ne cache pas sa “joie furieuse de l’avoir ressuscité”, car l’extase, le regard émerveillé de Xavier donnent une signification nouvelle, extraordinaire à toutes ses peines : “On écrit pour consoler et enchanter l’enfant qui est en nous” (p. 85). Paralysé par la douleur, poignardé par l’abandon, comment a-t-il pu survivre? Michel del Castillo évoque son secret de rescapé dans tous ses ouvrages et dans son journal qui est un Adieu au siècle:12
Aussi loin que je remonte en arrière, c’est dans la littérature que j’ai pu échapper aux angoisses et aux contradictions. La fiction m’en a plus appris sur la vie, sur ce que je voyais et ressentais que toutes les théories. (p. 15)
Je m’étonne toujours de l’intérêt que mes livres font naître. Je savais certes. Il y avait la stupeur de l’enfance. Il y avait la peur surtout: accepter de comprendre, c’eût été consentir à ma ruine, m’engluer dans la démence. J’ai donc avancé avec prudence, ne lâchant une prise qu’une fois assuré par la suite.
En attendant je reprends souffle. Je me repose dans mon amour de la France... J’écris sur Colette13 ... je rédige ce journal. (p. 19)
Pour l’enfant la lecture devient sa planche de salut pour “échapper au piège”, au cauchemar de ce silence d’orphelin: il ouvre alors les romanciers français, Balzac, Dumas, dit-il, “m’ont pris par la main”. C’est grâce à Dumas et à son personnage de Milady que l’enfant devine “dans sa vérité profonde” sa mère “redoutable”. Mais surtout Les Mille et une Nuits deviennent le Livre de cet enfant meurtri, abandonné par les siens, choqué:
Il y avait le merveilleux des contes, la séduction des apparences. Derrière ces enchantements, une forte et dure leçon toutefois se cachait, et cet enseignement, dissimulé derrière les charmes du récit, constituait l’ossature du texte, son squelette. Ce prince neurasthénique dont la perversion se manifeste par la fâcheuse manie de décapiter, dès l’aube venue, ses jeunes amantes, comment ne l’aurais-je pas reconnu alors que, avec la déflagration des bombes, avec le sifflement des obus, le crime rôdait autour de moi? Quant à l’astucieuse Schéhérazade qui, par l’art de captiver et de tenir en haleine, recule d’une nuit, puis d’une autre, de cent et de mille, l’heure de son exécution, comment n’aurais-je pas saisi sa stratégie de survie alors que je lisais, un mot après l’autre, pour prolonger moi aussi, le délai de mon agonie. (Journal, p. 16)
Lire, parler et écrire pour ne pas mourir: voilà le secret de cet enfant qui a “habité la folie” (Journal, p. 16). Autobiographie? Autofiction? ces ouvrages ne cessent de déconcerter, de troubler le lecteur par ce que Blanchot a défini “un ressassement continu”, l’encodage de sa propre mort à neuf ans. Ses livres semblent mimer non pas tellement le passé mais cette “course en avant” qui l’a sauvé de la folie, de l’univers concentrationnaire, de l’abandon. Ce sont des livres-refuges où sa haine implacable et son amour inépuisable semblent “se laver de toute souillure ».“Eclats d’or, de lumière et de sang”14, son Crime des pères nous ramène du côté et à côté de ses frères reconnus, les maudits, les personnages de Dostoïevski qui ont été pour Del Castillo une sorte de révélation. Il écrit à Fiodor: “Je suis né dans le décombre de tes livres” et dans son journal:
Dostoïevski m’a fait comprendre que je n’étais pas un monstre. Car lui aussi avait eu cette impression à force d’être le fils d’un monstre et de souhaiter la mort de son père. ... Ce secret m’a rapproché de lui. Nous communions dans la honte depuis tout petit et dans le désir de mort.15
Ėcrire pour donner un sens à sa révolte, à sa rébellion, pour expliquer où et comment il a retrouvé la force de “rebrousser chemin, de refaire tout le parcours, ramassant les cailloux que ma mémoire avait semés, j’en reste encore ébahi” (Journal, p. 16). De Tanguy16 au Crime des pères (1993), Du sortilègeespagnol - Les officiants de la mort à Rue des Archives, Del Castillo a choisi cet instant de vérité suprême: la Mort. La mort de celle qu’il n’a cessé de tuer:
Depuis des années, j’enterrais ma mère. J’imaginais chaque détail de son agonie. Je tentais d’apprivoiser sa mort ainsi que j’avais, dans mon enfance, tenté d’apprivoiser ce personnage. En tuant ma mère, c’est en réalité ma honte que j’aurais voulu supprimer. Non pas la honte de mais la honte tout court. J’ai la honte, comme d’autres ont la gale. Quand la mort a fini par frapper, j’ai aussitôt ressenti cette démangeaison. Rien ne s’est passé de la manière que je l’avais imaginé. Le décalage ne provient pas de l’écart entre fiction et réalité. Il résulte de mon infidélité à la seule réalité qui vaille, celle du langage. Je m’étais raconté des histoires pour échapper à mon histoire. Naturellement, la vérité du texte a fini par me rattraper. 17
Dans Rue des Archives, traduit en italien sous le titre La madre assente18, la Mort est là, dès le début avec tous ses aspects dégradants et rituels, une mort enfin survenue qui a frappé cette mère indestructible, qui a survécu aux tempêtes de la guerre civile, du camp de concentration, de la prison, de la dégradation, de l’abrutissement. C’est l’occasion pour l’écrivain de se demander, devant cette mort réelle, qui était vraiment -Victoria-Isabel ou encore Dina, cette femme à l’identité indéfinissable, de reconstituer le puzzle de cette énigme, de suivre avec Xavier sur une carte d’Espagne imaginaire, le périple existentiel de Candida et le sien/le leur: “L’enfant avait suivi le récit de bout en bout, sur une carte imaginaire de l’Espagne les périples croisés de Candida et les siens. Une géographie onirique où les lieux, les paysages, les villes devenaient autant de métaphores” (pp. 119-120). Une tentative qui aboutit à l’échec; tout indice, toute trace, toute photographie, tout papier le détournent de la vérité. Cette femme aux mille visages, mystérieuse et cruelle, reste le personnage que nous retrouvons au fil de ses ouvrages, belle et monstrueuse, Blanche-neige et sorcière, ange et démon mais surtout la grande Absente, la Gorgone “au regard de mort” (Journal, p. 61), l’“énorme cobra qui de façon imperceptible, bougeait, déroulait lentement ses anneaux, se dressait, balançait sa tête” (p.57). “L’absence est une diablesse aux cent visages: elle attise un feu sans éclairer.”19 Dans ce désert moral, parmi ces objets qui révèlent l’imposture, le mensonge - autre thème commun à nos auteurs - ces “débris d’une vie” fausse et tumultueuse, au milieu de la souillure que Michel nettoie avec un acharnement symbolique, l’ange apparaît: l’enfant qui l’accompagne dans cette plongée dans les archives de la mémoire. Xavier est un enfant au cœur pur (p. 60, “il y a en lui une pureté qu’aucune bassesse n’atteint”), à la “mémoire profonde”, plein d’amour pour cette mère qui ne l’a pas encore trahi ; Xavier est la réincarnation de Michel, avant l’abandon, un être de papier créé pour survivre à l’atrocité de la douleur20. D’abord présence silencieuse, les yeux hagards, Xavier parle. Ses mots sont doux comme une berceuse dédiée à la morte, ce sont les mots que Michel aurait voulu dire, qu’il ne peut plus dire:
“Dors maintenant... La course est terminée. Tu as franchi le poteau. Je ne t’en veux pas, je ne t’en ai jamais voulu... Dors maintenant dors”
Je restais stupéfait. Jamais encore mon double m’avait tenu un si long discours qui plus est, avec mes mots à moi et en outre avec mes paroles.... (p. 120).
Michel a choisi de vivre dans un univers de papier , “il n’y a rien de plus important que les livres”; “sa vie suit ses livres », et non pas le contraire. Impossible de définir son œuvre. Il l’écrit lui-même dans son dernier ouvrage:
Ni autobiographie, puisque ni vie ni sujet existaient, ni autofiction, puisque je ne suis pas le personnage que le texte bâtit: la tension entre une réalité folle et une mémoire disloquée. Les souvenirs me rendaient fou, je me suis donc inventé des récits probables, des hypothèses biographiques. Je ne dis pas la vérité, je la fais. (Journal, p. 21)
Le “je” que j’emploie volontiers n’est qu’un pronom, il ne désigne ni ne révèle le moi de la vie ordinaire. Je l’ai souvent répété: je suis mort il y a plus d’un demi-siècle. (Journal, p. 39 )
Si Dina-Isabel-Victoria-Candida (un nom qui révèle toute l’ironie qui sous-tend Rue des Archives) disparaît “derrière le masque de la Gorgone” (Journal, p. 39), son fils s’est “évanoui derrière le scribe”(Journal, p. 39), pour guérir du Sortilège espagnol, hérité de ce Sphinx au regard mortel. Pour oublier l’autre bourreau de son existence auquel il a consacré De père français (1998), autre terrible constat de mort:
Tous mes livres, depuis 1973, sont écrits du point de vue de ma mort. Jusqu’alors, je me raccrochais à des fictions pour me donner l’illusion de la vie. Ensuite je me suis résigné; j’ai fini par admettre que j’étais mort à l’âge de neuf ans. ... Assassiné de sang-froid avec préméditation. (p. 11)
Exilé dans son imaginaire, Michel y a trouvé “ses frères” disparus dans des personnages d’encre et de papier: son Xavier, au regard et au cœur purs et - dans Mon frère l’Idiot (1995) - Mychkine, prince de l’innocence. Il y a trouvé aussi la réponse à la question de l’enfant : “Et nous, dit l’enfant, d’un ton rêveur qu’est-ce que nous sommes? ” ; “Au total des métèques ... Notre vraie identité c’est la langue”(p. 176).
Le sortilège espagnol : Manrique et Ana del Jesus
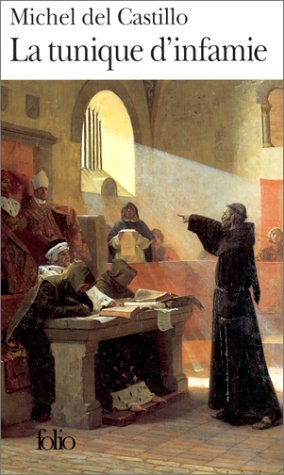
Dans les romans La tunique d’infamie (1997)21 et La religieuse de Madrigal(2006)22del Castillo renoue ses liens avec son identité espagnole, mais de façon complexe et frappante. Il remonte au XVIe siècle pour y retrouver, non seulement le passé tourmenté de ce Pays tant aimé et tant haï qu’il n’a pu arracher de sa partie la plus intime et la plus profonde, mais pour sonder son côté espagnol, son «hispanité, tantôt niée, tantôt exaltée. »23 Il y retrouve aussi paradoxalement un frère et une sœur, deux enfants comme lui dont la vie a été brisée par l’histoire, par la guerre et par la violence des hommes : Manrique, l’Inquisiteur et Anna del Jesus, la religieuse de Madrigal.
Je me demandais pourquoi l’inquisiteur Manrique m’obsédait à ce point. Je tentais d’éclaircir nos rapports, cherchais à me rappeler à quel moment il était entré dans ma vie. J’avais la sensation qu’il vivait en moi depuis l’enfance et que, de roman en récit, sa silhouette traversait tous mes livres. L’aurais-je poursuivi à l’autre bout de l’Europe s’il n’était qu’un caractère singulier ? Je devinais son histoire que je ne connaîtrais toutefois qu’après l’avoir écrite. Je ne savais de lui que des bribes : son enfance à Soria, ses études, son amour – un amour unique et vertigineux-, sa chute à Grenade. A quoi rime, me disais-je de passer tant d’années en compagnie d’un inquisiteur disparu depuis plus de trois siècles ? Je devais pressentir que cet ennemi des Juifs finirait par me livrer son secret et le secret de sa honte. N’ai-je pas révélé les miens ? Ne m’a-t-il pas choisi pour ça ? 24
Dans ces romans où il explore sans cesse les lieux, les voix et les visages de l’Espagne du Cinquecento se mêlent et s'affrontent l’histoire de l'Espagne et sa propre histoire, déchiré entre mémoire et oubli25. Il remonte au-delà des voix de Xavier et de Candida, dans ce qu’il appelle « l’obscurité des origines » (p. 29). Le dialogue entre sa destinée et celles de ses alter ego du XVIe siècle est incessant.
D’une ville à l’autre, il suit son frère Manrique, l’inquisiteur, pour déceler son secret. De Furnes à Soria, de Saint-Jacques-de-Compostelle à Lugo, de Salamanque à Madrid, de Madrid à Saint-Ambroix jusqu’à sa chute à Grenade, l’écrivain parcourt les différentes étapes de la vie de cet homme, fou de Dieu et hanté par la limpieza de sangre :
Tout à coup, il a resurgi devant moi. […]
Je l’ai senti tout proche, l’oreille collée à la porte… cela faisait des années qu’il suivait caché dans mes lectures et mes divagations, mes tours et mes détours, de Soria à Grenade, de Paris à Bruges. […]
Il possédait une évidence irréfutable. Pour le reconnaître, je n’avais nul besoin de le voir, ni non plus de l’écouter parler pour l’entendre. Je respirais son odeur, je percevais son souffle, j’éprouvais sur ma peau la brûlure de son regard. (pp. 15-16)
Orphelin, seul au monde (comme le petit Michel), élevé par un oncle érasmien (Del Castillo avoue avoir lu Bataillon, p. 54), Manrique découvre dans cette sorte de via crucis qui est son existence le secret de son passé, la honte de sa famille qui est aussi la honte d’un Pays. Pour Michel, Manrique est une sorte de « révélation », un « fantôme » qui vient de très loin :
Il avait vécu en moi depuis la minute de ma naissance, attendant l’instant propice pour se révéler. Il habitait sous ma peau, s’exprimait dans mes paroles, pensait avec mes raisonnements. Nous nous abreuvions à une seule et unique source.
Mes profondeurs baignent dans l’hispanité, tantôt niée, tantôt exaltée. Je ne me sens plus l’âge de lui échapper. (p. 25)
Tout commence à Furnes, dans ces Flandres enveloppées par la brume et la mélancolie des béguinages et où l'Inquisiteur Manrique va achever son existence. A quatre cents ans de distance, il s'efforce de découvrir les ressorts cachés de cet homme austère et inflexible en apparence, un homme qu'il situe à l'origine même de sa vocation d'écrivain. Entre Michel et son frère le dialogue s’instaure, profond, complexe, entre amour et haine ; il sonde Manrique, il cherche sans cesse Manrique, d’une ville l’autre pour trouver Michel, pour comprendre Michel et sa souffrance. Derrière le travail du biographe, la minutie des recherches et les interrogations, voici que son héros lui parle. Ce sont des lettres en italique concluant chaque chapitre, dans lesquelles l'Inquisiteur critique le travail du « Poète », « indigent et bavard », par-delà les siècles, souvent désabusé, parfois acerbe mais néanmoins satisfait de son choix.
Tu es exilé de toi-même. Tu m’évoques ces feuilles mortes que la tempête fait tourbillonner. Comment saisiras-tu ce sentiment fort d’une vie ancrée en elle-même, donc en Dieu, pivot de l’Univers ? (p. 37)
Mais où il révèle sa culture profonde, son éducation d’humaniste, ses lectures :
Or, Ėrasme nous ouvrait l’espérance en nous rendant la pureté du message évangélique. Plus tard, bien plus tard, je regardais son influence avec suspicion, sans toutefois mettre en doute la pureté de ses intentions. Mais emporté par son ironie critique, il avait ouvert la boîte de Pandore, laissant échapper les pires folies. C’était un poète à sa façon, l’un de tes congénères, et l’amour de la renommée, sa vanité d’auteur lui avaient tourné la tête. (p. 65)
Si j’ai admiré en effet le Don Quichotte de Cervantès, c’est à cause de son élévation. Ses leçons nous enseignaient à préférer l’échec dans la fidélité aux succès dans le parjure et l’abdication. Nous riions, certes, mais de nos faiblesses et de nos lâchetés. (p. 160)26
Platon lui « découvre la splendeur des métaphores » (p. 169).
Il le gronde, il lui évoque son devoir de mémoire :
Depuis que tu as fui en France ta part d’Espagne, tu te vautres dans le confort, que tu baptises la paix. Tu oublies ce que ta mémoire, ta personnalité doivent à ces soldats que tu brocardes.
Il l’interroge :
Poète, comment fait-on pour hurler la douleur ?
Et le Poète lui répond, dans ce dialogue prenant et troublant, à travers les siècles :
Je m’entends lui parler avec surprise. Je m’interroge : est-ce sa douleur qui m’oppresse ou est-ce la mienne que je lui transmets ? Quel lien bizarre nous attache à cette heure où je souffre de lui, avec lui ? Lui ai-je passé mes humeurs et mes déceptions ou a-t-il débridé mes plaies mal refermées ? Nous ne faisons plus qu’un dans la déréliction. (p. 187)
Une double quête d'identité s'engage. Quelle honte, quelle gêne embarrasse ainsi Manrique, l'empêchant, enfant solitaire et orgueilleux, de se mêler aux autres enfants puis, une fois adulte, de profiter des largesses de la Fortune ? Serait-ce que l'Inquisiteur, au fond de lui, se méprise d'infliger à ses contemporains les pires tortures, les supplices les plus atroces? Erreur de perspective, nous répond-il. Poète, tu juges mon époque depuis ton siècle qui n'a plus d'âme. Serait-ce alors cet amour violent, maladroit, interdit ? Peut-être. Mais là encore, l'hypothèse est incomplète.
Au bout de mes pérégrinations, je retrouve, bien sûr l’inquisiteur qui détient la clé de bien des mystères de l’Espagne, pauvres secrets de ruse et d’imposture. (p. 173)
Don Manrique introduisait des dissonances proches du grincement, qui m’effrayaient. (p. 29)
La tunique d'infamie, c'est cette robe dont on revêtait l'hérétique le jour de son supplice, sur laquelle on inscrivait son nom et que l'on suspendait dans la cathédrale de la ville, de telle sorte qu' une famille, une fois souillée, le demeure jusqu’à la fin des temps. C'est cette tache qui nous plombe l'âme, du fond de notre inconscient, nous empêche d'avancer, nous condamne toute notre vie à tourner en rond autour d'une unique et secrète douleur. La Tunique d'infamie est un magnifique chant à deux voix par-dessus l'abîme du temps. Michel del Castillo évoque dans ce roman la terrible procédure de déclenchement de l'Inquisition: un billet sans signature, glissé dans l'une des boîtes installées dans chaque village d'Espagne par le Saint-Office, suffisait à précipiter d'innocentes victimes dans l'horreur de la torture ou du bûcher. Jusqu'à la fin de son procès, l'inculpé ignorait le nom de celui qui l'accusait, seulement désigné sous le terme d’ «ennemi capital». Dans ce roman « double » qui semble l'œuvre d'un schizophrène, Michel del Castillo cherche aussi le mystère de son écriture. Il nous offre la compassion, la compréhension de l'autre, aussi abominable, aussi inhumain qu'il puisse nous paraître. Au fil des pages, on perd l'envie de juger l'Inquisiteur ; sans aller jusqu'à l'aimer, on finit par souffrir avec lui, et l'on découvre que seul est inhumain ce qui nous sépare de ce partage. Del Castillo sonde, au plus profond, en lui-même, pour découvrir le gène Inquisition qui empoisonne toujours notre sang, cette incurable et cruelle nostalgie de l'Un, bien plus vivace que l'amour. Mais La Tunique d'infamien'est pas un roman historique sur l’Inquisition, et non pas davantage la description en sang et en or, parfois complaisante, d'une Espagne des bûchers et des tortionnaires en proie à l'hystérie nationale-religieuse, traquant le juif converti sous le chrétien dévot, le musulman sous le morisque, la sorcière sous la femme, l'hérétique sous le lettré. Au contraire l’auteur y exprime toute sa méfiance envers le roman historique :
Je ne voulais pas que les miroitements d’un faux décor détournent l’attention de Don Manrique. En outre, je déteste les reconstitutions. Il y a un mensonge inhérent au roman historique, qui anesthésie toute angoisse en donnant l’illusion qu’on peut appréhender le passé parce qu’il existerait, par-delà les différences, une nature humaine, égale à toutes les époques. Or, ce postulat ne pourra jamais être prouvé ; nous ne saurons jamais ce qu’un homme du XVIIe siècle a vraiment ressenti, ni quels furent ses enthousiasmes ou ses angoisses. Nous ne saurons jamais ce que ses yeux voyaient, ce que ses mains palpaient. (p. 33)
Comme tous les romans de Michel del Castillo, celui-ci creuse, par l'écriture, le mystère d'une histoire singulière - qui suis-je ? - de telle façon qu'elle se mêle à l’histoire plurielle de ses lecteurs : que l’improbable "je" devienne enfin, dans le travail de deuil de la littérature, un "nous". Dans cette recherche de soi inséparable de la perte - "je suis mort, répète l'écrivain, seule l'écriture me donne l'illusion de vivre" - Dostoïevski représentait la figure d'identification la plus proche : il était "mon frère l'idiot", celui dont il est possible de partager l'humanité, la souffrance, le désordre et même les faiblesses et les lâchetés. Manrique, l'inquisiteur, appartient au pôle opposé, à la répulsion, à cette part d'Espagne que Del Castillo porte en lui comme une tare haïssable. Dialoguer avec ce qui vous est contraire, le laisser pénétrer en vous en l'imaginant, en faire un frère ennemi mais frère quand même, suppose davantage que de la lucidité : à force de vouloir comprendre son personnage, Del Castillo prend le risque de l’aimer et de le faire aimer au lecteur qui partage sa souffrance et son calvaire qui l’a transformé de victime en bourreau. D’où la tension, admirable et insupportable, qui, à la fois, meut ce livre et l’immobilise comme le ferait une crampe. Manrique - Michel del Castillo a repris le nom d’un inquisiteur célèbre mais qui vécut un demi-siècle avant son personnage, à l'époque de Charles Quint 27- est l’image même du fanatisme tranquille. Il ne cherche ni les plaisirs28, ni l’argent, ni même le pouvoir. Il n'est animé ni par la haine ni par un quelconque ressentiment. Il aime la vérité, il pourchasse ceux qui croient pouvoir ruser avec elle ; en premier lieu les conversos, les juifs convertis de force, dont chacun soupçonne qu'ils ne sont pas, qu'ils ne seront jamais - question de sang, plutôt que de foi - de vrais chrétiens. Manrique est un adversaire redoutable ; sa dialectique est affûtée, sa moralité irréprochable, son art de la question consommé. Placé par l'auteur en posture d'accusé, il a tôt fait de retourner la situation à son avantage et de mettre les certitudes de l'écrivain - les nôtres - à la torture. Par une belle et étrange dérive, sans cesse justifiée par une construction impeccable, l'écrivain et sa créature échangent leur rôle. Manrique devient l'auteur d’une fiction dans laquelle l'écrivain occupe le statut de personnage. L’un est le roman de l'autre, la projection imaginaire d'une partie de sa réalité. Ils se toisent, ils s'évaluent, ils se comprennent, ils se méprisent, s’ exprimant ici tout à la fois la réflexion et la réciprocité. "Est-ce sa douleur qui m'oppresse ou la mienne que je lui refile ?", se demande le romancier. Manrique, à la fin du livre, découvre ce qu'il s'est toujours caché et que sa foi ne pouvait admettre : il est juif, comme le sont, quand ils ne sont maures, la plupart des habitants de la région où il est né. "Son moi se désagrège sous ses yeux. De ce qu'il croyait être, rien ou presque ne subsiste. Que reste-t-il d'une vie menée dans le mensonge et dans l'aveuglement ?." La même question se pose pour le romancier. Rien n'est plus espagnol que ce roman écrit en français. Rien n’exprime avec une force telle l'abandon orgueilleux au destin. C’est le mystère d’une Vie mentie29que Michel del Castillo dévoile pour dévoiler ses propres angoisses, son double bind, son être « entre-deux » :
Un jour, Manrique répère un écrivain aussi seul et désolé que lui. Ils referont de paire la longue route, depuis Soria jusqu’à l’exil.
Dix ans ils chemineront ensemble.(p. 317)
« Ana de Jésus, c’est moi ! » : Ana, « métaphore éloquente de mon destin »

Et toujours dix ans (p. 35) a cheminé avec l’auteur Ana de Jésus, autre enfant du malheur dont le destin est déjà tracé avant même sa naissance. Ana d'Autriche, fille de Don Juan, demi-frère de Philippe II, roi d'Espagne, sera recluse dans un couvent30. À l'âge de six ans, en 1575, sa tante la conduit au monastère de Madrigal. Pourtant, à la veille de sa profession solennelle, Ana de Jésus se révolte, refuse d'abdiquer sa liberté. Elle devra s'incliner, mais un homme qui dit s'appeler Gabriel d’Espinosa arrive à Madrigal. On prétend qu'il s'agit de Don Sebastian, le roi disparu du Portugal. Une passion forte naît entre ces deux personnages égarés. Passion fatale, car Philippe II veille sur cette enfant du malheur. Encore une fois Michel del Castillo plonge dans le passé espagnol et retrouve, dans une époque des plus tourmentées où nous voyons sur l’arrière-fond don Juan exterminer les Morisques et brûler leurs domaines enchantés, les « cicatrices de la haine et du fanatisme » (p. 54).
Dans ce roman identitaire31 Del Castillo ressort la honte et l’angoisse d’un passé qui le tourmente et qui ne cesse de hanter son présent. Il redit d’ailleurs dans sa Préface ses « fortes réserves sur le roman historique, genre hybride qui, à la peinture souvent rigoureuse et sensible d’un climat, croit devoir ajouter un psychologisme anachronique et trivial » (p. 9)32. Pas de « reflet exact de ce qui se serait passé » car
je récuse cette illusion. Je ne crois pas à la vérité, seulement à des approches et à des tâtonnements. Je n’accorde qu’une confiance mitigée aux documents, lesquels, autant que la parole peuvent mentir. Fidèle à ma manière c’est la généalogie d’une fable que j’ai choisi de raconter.
Je songeais à ce livre depuis des années. C’était devenu une obsession. Sœur Ana de Jésus parasitait mes pensées. J’ai d’ailleurs incorporé dans le récit les raisons que j’avais de me reconnaître dans cette femme ayant vécu il y a plus de trois siècles. Ce livre est tout sauf un exercice gratuit. (p. 10)
Ana est pour lui un modèle incarnant le mythe de l’enfance brisée, prisonnière (comme l’auteur l’a été en Allemagne) dans sa prison-monastère, « retranchée du monde des vivants et luttant pour retrouver sa liberté » (p.12) (presque une autre Virginia de Leyva, la « monaca di Monza » d’ Alessandro Manzoni ou une nouvelle Antigone, p. 13, incarnant le conflit entre la Loi et la protestation d’une subjectivité brisée). Histoire symbolique qui veut donner une voix aux « oubliés » de l’Histoire, les religieuses sans vocation, les femmes, les juifs chassés de leurs terres, les 50.000 mille Moriscosque nous voyons traverser le Pays enchaînés et disparaître dans la neige et le froid des montagnes, à ces « massacres crépusculaires » (p. 41).
Le même sort unit ces frère et sœur unis par ce que l’auteur définit « une obscure fraternité » (p. 45).
Je naquis pareillement dans une atmosphère de haines déchaînées, de règlements de compte et d’assassinats politiques. (p. 45)
« Les seules fleurs étaient les adelfas du cloître »
Roman magnifique au style « volontairement dépouillé » (p. 11), sous le signe d’Isabelle de Castille qui était née à Madrigal de las Altas Torres, et qui sort, comme une fleur rose, d’un mot espagnol, adelfa
Tout est parti d’un mot, adelfa, qui signifie laurier-rose. Autant le terme français est logique, indiquant l’espèce botanique, ensuite son efflorescence, autant le vocable espagnol renferme une indécision poétique. Masculin le premier, d’une sèche exactitude, féminin le second, vaporeux et musical ; le français renvoie à la définition, le castillan à l’impression et au sentiment (p. 17)
j’ai souvent imaginé qu’Ana contemplait avec douceur les adelfas d’où ce livre est sorti. ( p. 78)
Je me pose la question : lui arrivait-il d’arroser les adelfas ? (p. 79)
Voit-il [Gabriel] les adelfas dont ce livre est sorti ? (p. 179)
car ces fleurs étaient « les seules fleurs … du cloître » , la seule trace de couleur et de vie dans l’architecture implacable et grise de Madrigal, dans cet «univers minéral » indifférent au sort de l’enfant isolé du monde :
Comment … ressentirais-je l’impression de silence et d’oppression que la petite Ana dut éprouver en descendant de la litière de sa « tante » ? Comment retrouverais-je son sentiment d’angoisse devant ces murs attristés ? Si je voulais m’approcher d’elle, je devais, au lieu d’entreprendre un long voyage, renouer avec ma mémoire, affronter ce choc qui, dans mon enfance d’orphelin, m’a plusieurs fois glacé de terreur en découvrant ces décors barbares. Les murs nus, de ce gris qui donne à tant de villages de Castille leur aspect dur et méprisant ; les grosses clés, détenues les unes par le chapelain chargé de veiller sur la clôture extérieure, celles de l’intérieur attachées par une corde à la ceinture de la sœur tourière, femme lourde, engoncée dans son habit noir et blanc, marchant avec peine. (p. 20)
Ici aussi l’architecture et « la géographie romanesque rejoi[gnent] …celle de l’âme castillane, de ses raideurs et de ses exaltations. Cet espace onirique renferme mes nostalgies intimes. Mon cœur ne parvient pas à se déprendre de ces solitudes altières, aujourd’hui abandonnées. » (p. 11)
On retrouve dans La Religieuse de Madrigal tous les thèmes chers à Michel del Castillo : l'enfance brisée par le choc et la quête identitaires, les horreurs du pouvoir, la passion de la liberté, la chimère et l'illusion, l’exil et le déracinement, la réflexion sur l’histoire et surtout sur ses époques les plus sombres, leitmotive de son œuvre qui ressuscite surtout le XVIe siècle de l’Inquisition et le XXe siècle de Franco et de la guerre civile. Le destin de Ana, sa révolte et le conformisme écrasant de Philippe II occupent l’auteur depuis des années. Et l’on reconnaît, en effet, dans ce roman de la coupure du monde toutes les obsessions qui hantent Michel, stylisées - tout comme sont stylisées sa documentation historique et sa connaissance profondem, presque amoureuse de son Pays. Ana de Jesus: c'est sous ce nom qu'elle apparaît d'abord, un nom d'emprunt qu'on lui impose dans les murs sombres du monastère de Madrigal où elle a vécu son enfance, prisonnière. Plus tard, quand tout sera clair, elle deviendra Ana d'Autriche, son nom de lumière. Un échange de noms qui est aussi un jeu identitaire, cher aux écrivains de la diaspora comme Del Castillo, comme Semprun ou comme Romai Gary…. D’une écriture sèche et enflammée, Michel del Castillo, dont l'enfance ressemble à celle d'Ana à bien des égards - enfermement, mensonge, abandon, choc ... -, interroge dans ce roman, où l’on peut retouver l’ombre de Machiavel et de Don Quichotte, le destin d’Ana qui est aussi le sien. La religieuse de Madrigal dessine en creux l'image de l'auteur, un enfant abandonné qui souffre encore soixante ans plus tard. Tout le récit est ponctué de remarques de l’auteur comparant sa propre destinée d’enfant jadis abandonné à celle de la novice de Madrigal :
Nous sommes tous condamnés à une solitude essentielle. C’est peut-être pour tenter d’y échapper que j’écris, et je me demande si ce n’est pas cette solitude que j’ai reconnue lorsque j’ai rencontré la petite Ana, ma sœur jumelle. (p. 77)
Je ne peux saisir la petite Ana de Jésus qu’à travers mes expériences ; ses sentiments et ses pensées me demeurent inaccessibles – postulat qui me dicte la composition de ce livre, par tatônnements et repentirs, un incessant va-et-vient de moi à elle, d’elle à moi . (p. 23)
Les raisons pour lesquelles la figure de cette fillette ayant vécu il y a plus de trois siècles m’a poursuivi depuis des années, je les connais : je sais aussi pourquoi, dans mes pérégrinations et mes voyages, dans mes insomnies et dans mes rêves, sa présence revenait, obsédante, comme l’un de ces airs dont on ne parvient pas à se défaire. Près de dix ans de lectures, de rumination, de rêveries, j’ai tourné autour de ce fantôme. Je continuais de vivre, d’écrire, je revenais toujours vers elle. (p. 35)
Orphelin, oublié de tous, comment ne me reconnaîtrais-je pas dans cette fille rejetée ? (p. 60)
Il évoque les sensations morales et physiques du choc :
Le froid, un froid terrible, inhumain vous pénètre ; on coule dans un état d’hébétude comme si l’esprit, incapable de supporter la violence des regrets, plongeait dans l’engourdissement. Cette phase de léthargie dure des semaines, des mois. (p. 75)
C'est un livre auquel Michel del Castillo pensait depuis des années (Ana come Manrique a vécu avec lui longtemps, très longtemps), qu'il a nourri de nombreuses lectures, et dont il avoue, dans la préface : "Avec ces personnages, c'est sur une partie de ma vie la plus secrète que je projette la lumière de la publication". Car avec la petite Ana de Jésus, la "religieuse de Madrigal", c'est une sœur jumelle au destin spéculaireque l'auteur évoque : « Nos vies ne connaissent qu'une maladie, l'absence d'amour. On s'accommode de tout ou presque, sauf de ce vide ».Nièce de Philippe II, fille de Don Juan (lui-même fils naturel de Charles Quint) et de Maria de Mendoza, Ana d'Autriche n'a que six ans quand on la conduit, un jour de 1575, au couvent de Madrigal de las Altas Torres où elle prend le nom d'Ana de Jésus. La vie d'une bâtarde ayant souillé le sang royal doit se dérouler à l'ombre. Pire : non reconnue, elle n'existe pas. « La convenance exigeait que le désordre de sa naissance s'arrêtât avec elle ».Mais à la veille de prononcer ses vœux, Ana se révolte en vain. Privée de sa liberté, elle bénéficie toutefois d'un statut particulier derrière la clôture, sachant désormais tout de ses origines : son père est le héros de la bataille de Lépante, son conle le roi d’Espagne. Quand son confesseur lui fait rencontrer Gabriel de Espinosa, sa vie reprend. On prétend qu'il s'agit de Don Sebastian, le roi disparu du Portugal. La passion va bientôt emporter ces deux êtres égarés, jusqu'à les perdre. Des faits réels entoruées de mystère, d'incertitude ; ni l'identité de Gabriel, ni ses vraies origines, ne furent jamais découvertes. Né en littérature avec Tanguy en 1956, Michel del Castillo n'a, pas plus qu'Ana, été désiré, son enfance lui a été volée, et la solitude, peuplée de livres, a été longtemps sa seule compagne. Seuls l'orgueil et la fierté on permis à tous deux de survivre à ce « vide » immense, à ce gouffre que l’absence des parents a creusé dans leur me. Mais La religieuse de Madrigal est bien plus qu'un texte nouant deux destins par-delà les siècles. C'est d'abord une question sur ce qui fonde nos vies (« Qu'est-ce qui n'est pas illusion dans l'existence de chacun ? »), notre identité, sur l'essence de l'amour, sur le pouvoir et l'ambition. C'est encore l’histoire « d'une Castille aujourd'hui disparue », emblématique de l'identité espagnole. C'est enfin une profonde remise en cause du roman historique,« genre hybride » qui se nourrit à l'illusion de l'objectivité, à la « vérité » de l'écrit, un genre que l’auteur met et remet en question. Face à ce constat, et en l'occurrence au traitement que des historiens ont réservé aux personnages, à Anna et à Gabriel, del Castillo n’a pu qu'éprouver un malaise, et réagir :
Je ne fais, de mon côté, rien d'autre que traduire une histoire dans la langue de la littérature qui n'est ni plus juste, ni plus exacte, seulement plus incertaine et plus inquiète. Installée dans la fiction - un mensonge, si l'on veut -, elle permet d'approcher au plus près une certaine vérité, puisque, toute langue cachant un secret de domination, la littérature avoue le sien qui est de creuser, fouiller pour dépasser la réalité.
Ainsi del Castillo préfère sonder les incertitudes et les doutes, réduisant la psychologie des personnages à la « portion congrue », explorant l'énigme d'une passion et le mystère de l’identité d'un homme et d’une femme, le secret de leur amour et la violence de l’histoire des hommes qui brise leur chimère. La religieuse de Madrigal est née des couleurs des adelfas, mot plein de suggestions en espagnol, que la traduction française (laurier-rose) évacue de toute poésie, lu dans la description d'un couvent de la vieille Castille. Une fleur qui fait naître le roman d'Ana, après une longue gestation chez un écrivain que l'écriture a semble-t-il sauvé de la « solitude essentielle » à laquelle « nous sommes tous condamnés ».
Au mois d’octobre 1953, j’échappais à l’Espagne de Franco et réussissais à gagner la France. Si j’étais dès lors sauvé du conformisme et de la médiocrité, je ne l’étais pas pour autant de mes contradictions. L’Espagne continuait en effet de me hanter comme une maladie vague et diffuse. Je souffrais continuellement de ce pays aux charmes ambigus. Je menais avec lui un dialogue passionné.
Ces quelques lignes de la postface du Sortilège espagnol constituent une magnifique introduction à la vie et à l’œuvre de Michel Del Castillo. L’histoire d’Ana d’Autriche, fille bâtarde de Don Juan, demi-frère de Philippe II, roi d’Espagne, lui-même bâtard, est un récit, comme La tunique d’infamie, marqué par l’esprit de la limpieza de sangre qui dominait alors “ce pays victime d’un enchantement délétère“, mais aussi d’une critique lucide du roman historique. A commencer par la digression autobiographique qui ouvre le texte et évoque sa présence, directe et sans tricherie, tranquille, dans le corps du récit. Ana de Jésus, c’est Michel, dans toutes ses ambiguïtés, ses contradictions, ses fuites, son abandon à 6 ans, son enfance brisée. Au-delà de la rigueur de la documentation, l’Histoire est ici fiction littéraire, mais rien à voir, insiste Del Castillo, pour autant avec un roman historique traditionnel, genre que del Castillo exècre pour “son pyschologisme“, cette démarche génétique systématique, sa façon de tout expliquer par les sources quand une fleur, une larme, un geste en disent bien davantage. Le paratexte est particulièrement éclairant. “Enchaîner un personnage à la fatalité de son enfance, c’est nier sa liberté”, insiste-t-il, avant d’ajouter : ” Nous rêvons pour oublier ce que nous sommes. Il arrive que nos chimères fassent notre réalité”.
Et que d’une fleur rose et solitaire, d’un mot « adelfas » sorte un roman …33
Anna, soror…
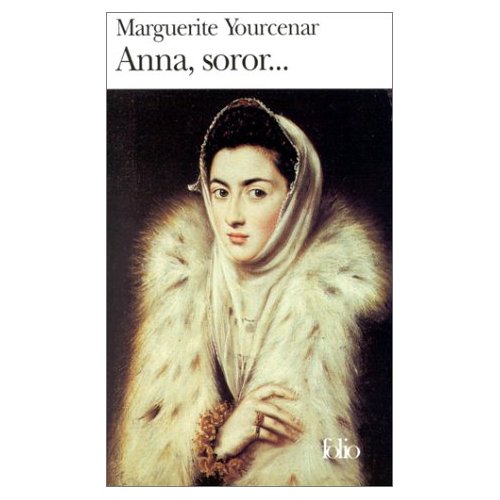
1575 : une autre sœur, une autre Anna, naît dans la sombre Naples espagnole du XVIe siècle, où va triompher bientôt, contre la réforme spirituelle des alumbrados incarnée par la religiosité de la mère, Valentina,34 élevée à l’ombre de Vittoria Colonna, la Contre-Réforme et le faste somptueux de ses cultes voyants…
Le titre est repris d’un vers l’Enéide (livre IV, 9) où Didon s’adressant à sa sœur lui dit : « Anne, ma sœur, dans mon cœur bat l’ancienne flamme »35. Dans ce roman le frère et la sœur que nous avons rencontrés chez Del Castillo se retrouvent, unis dans un lien qui va au-delà des sentiments permis entre frères. Il s’agit en effet d’un inceste, un « amour entre frère et sœur à la Renaissance ». Anna et Miguel sont les enfants de don Alvaro, marquis de la Cerna, gouverneur du Fort Saint-Elme, dont nous suivons l’éducation raffinée que leur mère Valentine, issue de la Cour d’Urbino, leur donne dans une sorte d’état de fusion et d’isolement du monde. Anna, soror... est une œuvre de jeunesse, un livre « écrit en quelques semaines du printemps 1925 (elle a 22 ans), au cours d’un séjour à Naples et immédiatement au retour de celui-ci. … ».
Jamais invention romanesque ne fut plus immédiatement inspirée par les lieux où on la plaçait. J’ai goûté pour la première fois avec Anna, soror … le suprême privilège du romancier, celui de se perdre tout entier dans ses personnages, ou de se laisser posséder par eux. Durant ces quelques semaines, et tout en continuant à faire les gestes et à assumer les rapports habituels de l’existence, j’ai vécu sans cesse à l’intérieur de ces deux corps et de ces deux âmes, me glissant d’Anna en Miguel et de Miguel en Anna, avec cette indifférence au sexe qui est, je crois, celle de tous les créateurs en présence de leurs créatures. « (Postface, p. 104-105).36
Anna et Miguel sont donc l’une des premières incarnations de ces personnages-obsessions qui hantent Marguerite Yourcenar, qui mûrissent avec elle et qui incarnent ses sentiments les plus profonds, sa conception existentielle de la littérature. Anna et son frère, avant Nathanaël, Zénon et Hadrien…
C'est aussi l'esquisse un fragment de son roman-fleuve Remous (d'un « roman-océan », ironise l'auteur) qui ne vit jamais le jour mais qui « contenait en germe une bonne part de mes productions futures » (p. 95) et duquel sont issus divers ouvrages parmi lesquels La mort conduit son attelage et L'Œuvre au noir. Si Marguerite Yourcenar opte finalement pour a brièveté de la nouvelle, la genèse du texte est pourtant complexe ainsi que le révèle l’important paratexte qui l’accompagne:37
21-26 Remous
1925 Anna, soror… fragment de Remous
1934 La mort conduit son attelage, 3 fragments de Remous
D’après Rembrandt
D’après Dürer
D’après Greco38
1981 Anna, soror
1982 Comme l’eau qui coule
47 ans : d’une version l’autre des milliers de variantes (2 mille) qui mettent en doute l’affirmation de l’auteur dans sa Postface, « presque le même ». Anna figure tous les deuils, elle s’inscrit à la place de ce qui a disparu. Il s’agit d’un texte endeuillé, seul et dont la révision a eu lieu à la mort de Grace Frick. Un texte qui multiplie les scènes funèbres (la mère, Miguel, Anna…) et pour lequel la Passion du Christ joue un rôle fondamental. D’après Grecocommençait par une Préface, le récit était une vaste analepse qui s’étendait pour 4 chapitres. Anna, soror est un récit en 5 chapitres suivis d’une Postface, « déstabilisante » par ses proportions
De Gréco à Caravage
Dans ce texte, beau comme un tableau du Caravage, entre les lumières et les ombres, entre Naples et les Flandres, s'embrase et se consume l'amour entre Anna et Miguel. Leur passion porte les stigmates du péché et de l'enfer car Anna et Miguel, nouveaux Thamar et Absalom39, Caunus et Byblis, vont payer très cher leur amour interdit et incestueux (le thème de l’inceste est important car dans sa Postface l’auteur parcourt la littérature à la recherche d’autres textes où le thème apparaît)40. Dans cette Naples de la Contre-Réforme, "la notion sociale de l'interdit se double de la notion chrétienne de la faute". Pourtant, nul regret ne tourmente Miguel, et Anna éprouve jusqu'à sa mort un amour sans repentir, voire religieux, pour son frère. Remous était le premier titre de cette nouvelle qui tend à rappeler l'étrange état de toute existence : celui où « tout flue comme l'eau qui coule, mais où les faits qui ont compté émergent à la surface et gagnent avec nous la mer ». On retrouve dans Anna soror..., comme dans les œuvres majeures de Yourcenar (Mémoires d'Hadrien, L'Œuvre au noir), l'obsession héraclitéenne du temps qui passe et sculpte les êtres.
Dans ces pages s’insinue le serpent du désir qui peut emporter loin, très loin (cf. p. 17) :
Anna avait horreur du Mal, mais parfois dans le petit oratoire devant l’image de Madeleine défaillant aux pieds du Christ, elle songeait qu’il devait être doux de serrer dans ses bras ce qu’on aime, et que la sainte brûlait sans doute d’être relevée par Jésus. (p.17)
Miguel aussi pense à Caunus et Byblis (p. 18)41 lorsqu’il rencontre la fille, la « pythonisse », aux serpents et aux yeux jaunes (p. 19, jeu de mots ma sœur/mon frère ; p. 21, encore la fille aux semprents, vipères cette fois ; le jaune est associé au divin à la voyance)42 dans la ville morte, emblème de la Grande-Grèce entre Crotone et Métaponte (p. 31), une ville-symbole, présage du mal et de la mort, incarnés par ces serpents qui vont s’insinuer dans leur cœur : « car les vipères, Monseigneur, ça rampe partout, sans compter celles qu’on a au cœur. » D’autres rêves et cauchemars font irruption, tristes présages de mort comme ceux de Didon : scorpion et serpents, entrelacs et pieds nus… Miguel se souvient aussi que sa grand-mère, descendante des Lusignan, prit « l’apparition soudaine d’un serpent pour un augure de mort » (p. 31).
Aux lieux de la mort, fermés : le coche (p. 33), les couvents, la « grise forteresse » où croupissent emprisonnés les suspects d’hérésie, les bouges sales, les églises sombres, encombrées de statues et de crucifix pleurant ou saignant, s’opposent les lieux du soleil et de l’enivrement, le château des vendanges et les ruines brûlées par le soleil, le studiolo (« la petite pièce dorée »)de Valentina, beau comme celui de son parent Guidobaldo de Montefeltro (Valentina est la petite-fille d’Agnès de Montefeltro) au palais ducal d’Urbino, la lumière de ses sardoines. UT CRYSTALLUM était sa devise :
Miguel passait de longues heures assis à côté d’Anna dans la petite pièce dorée comme l’intérieur d’un coffre, où courait, brodée sur les murailles, la devise de Valentine : Ut crystallum. Dès leur enfance, elle avait appris à lire dans Cicéron et dans Sénèque : tandis qu’ils écoutaient cette voix tendre leur expliquer un argument ou une maxime, leurs cheveux s’entremêlaient sur les pages. Miguel à cet âge ressemblait beaucoup à sa sœur43; n’étaient les mains, délicates chez elle, durcies chez lui par le maniement de la bride et de l’épée, on les eût pris l’un pour l’autre. (p.12)
Elle avait, dans une cassette, une collection d’entailles grecques dont plusieurs étaient ornées de figures nues. Elle montait parfois les deux marches qui menaient aux profondes embrasures des fenêtres pour exposer aux derniers rayons du soleil la transparence des sardoines, et, tout enveloppée de l’or oblique du crépuscule, Valentine elle-même semblait diaphane comme ses gemmes. (p. 12-13)
Au noir du péché, des tavernes et des prisons s’oppose la blancheur de Valentine, sa lumière calme et son existence presque monastique, son néoplatonisme mystique, son pythagorisme (p. 24 « Valentine songeait peut-être aux sphères de Pythagore »), les couleurs de ses enfants blonds et « blancs » (Anna est « blanche », p. 25/ la fille aux serpents, d’origine morisque, grise ; noires, les courtisanes fardées, p. 48). Aux dits s’opposent les non-dits, les blancs typographiques, les silences. Les espaces et les lieux, ouverts ou fermés, les objets ont tous une fonction symbolique manifeste ainsi que ces volets (p. 46) entrebâillés, ces portes (p. 43, p. 46) et ces fenêtres (p. 48), ces balcons (p. 59), ces seuils, ces embrasures (p. 25, p. 47) où les regards se faufilent, où les corps se montrent volontairement ou par hasard.
Les personnages agissent dans une atmosphère où l’ivresse (p. 42) et l’enivrement des vendanges44, le parfum du moût (p. 39) évoquent de lointains cultes bachiques, mais aussi la fièvre des sens, la passion qui va emporter Anna et Miguel… Tout est enveloppé par ces rituels de mort, rythmés par des cultes et des pratiques religieux fastueux et physiques :
Sa tête un peu renversée, ses lèvres disjointes, rappelaient à Don Miguel le mol abandon des saintes en extase que les peintres représentent presque voluptueusement envahies par Dieu. (p. 39)
Dans l’église des Lombards (Monte Oliveto) Anna agenouillée « penchée sur le mort d’argile étendu sur les dalles, elle baise dévotement les plaies du flanc et des mains trouées. (p. 51)
Ils vivent dans un mélange constant de sacré et de profane : les lèvres qui se tendent pour recevoir l’hostie (p. 26) ; le culte des reliques et des statues « violettes » (p. 52) ; la lecture des mystiques espagnols : Louis de Léon, Jean de la Croix, Thérèse d’Avila au « vocabulaire ardent et vague de l’amour de Dieu » (p. 39) 45; tout concourt à précipiter « sur leur pente » (p. 42), à faire éclater le drame du désir(p. 55) et de la passion/Passion.
Un blanc, un silence, seul le bruit du flottement de l’écharpe … le navire doit partir vers le néant. Trois jours plus tard…. Le jour de la Pâque de l’Ange « parce qu’un envoyé céleste y parla autrefois à des femmes au bord d’un tombeau », le drame est accompli. La mort l’attend.
Le deuil de Anna commence, immobile et implacable, comme l’évoque l’épitaphe gravée sur la plinthe/plainte 46:
luctu meo vivit
anna de la cerna y los herreros
soror
campanie campos
pro batavorum cedans
hoc posuit monumentum
aeternum aeterni doloris
amorisque
Anna de la Cerna, âgée de vingt-cinq ans, était aussi l’aînée. Elle portait le noir depuis la mort de son frère, tué trois ans plus tôt au service du roi, et la somptuosité des étoffes donnait quelque chose de fastueux à son deuil. (p. 77)
Anna, qui mourra en prononçant ces mots :
- Mi amado. Ils pensèrent qu’elle parlait à Dieu. Elle parlait peut-être à Dieu.
est désormais l’image du soleil noir de sa mélancolie qui l’accompagnera en Flandre, dans l’exil, toute sa vie durant. « Tout est fini, et pourtant « ça » continue »47.
Ėtrange destinée que celle d’Anna, « figure de seuil »48, qui semble évoquer la parabole existentielle d’une autre jeune fille, elle aussi d’origine espagnole devenue tristement célèbre : Lucrèce Borgia, mais dont la vie a été récemment revues par les historiens contemporains49. Anna tient aussi de Marie-Madeleine, Miguel du Christ au flanc ouvert.
Légende aux couleurs blanches, grises, noires et violettes, texte baroque, « bougé » historique, ce récit est un récit fondateur, mais surtout un magnifique « tombeau » où le parfum du moût sauvage, le mauve, le luxe violet et baroque des églises napolitaines se mélange au fleuve noir nommé désir qui nous emporte loin, très loin jusqu’à la mort. Eros et thanatos s’unissent dans l’art et la dévotion, loin de l’agâpe de Valentine.
Anna, retouche après retouche, devient une statue du Bernin.

Mais Anna, soror… est aussi le récit d’une écriture et de ses aventures.
« Je me sens tout autant de plain-pied avec ce récit que si l’idée de l’écrire m’était venue ce matin ». Anna,soror… c’est aussi la seule des œuvres à propos de laquelle Marguerite Yourcenar évoque le sentiment d’avoir été captive de ses personnages »50. « Le temps avait jeté bas ses barrières et rompu ses grilles » (p. 93).
L’Antiphonaire (1969) ou le roman épileptique
De même, dans la vaste symphonie romanesque L’Antiphonaire (1969)51de Hubert Aquin, le temps semble aboli. Le lecteur se déplace selon deux axes chronologiques intermittents : XXe et XVIe siècle, entre la Californie et le Québec et l’Europe des imprimeurs libraires, des chemins de l’hérésie. Le déplacement des axes spatio-temporels est continu et connoté par un manque de stabilité. « Je me meus sans émotion dans un espace-temps dont les frontières sont difficiles à discerner » (p. 17)52.
45 chapitres, 18 formes d’écriture pour raconter l’histoire de Christine et de sa Thèse sur un médecin du XVIe siècle, Jules-César Beausang (dont les modèle sont Paracelse et des humanistes, comme Scaliger ou Agrippa). Beausang meurt en 1536, comme Erasme avec lequel il partage certains traits, tout comme avec Vésale et Fracastor.
« Que dit Hubert Aquin dans ce roman touffu, à l’érudition troublante? Que l’homme est seul. Que la femme l’est peut-être davantage. Et, comme l’a dit saint Bonaventure, qu’il faut savoir mourir et entrer dans l’obscurité. »
Le roman commence par une crise épileptique. L’épilepsie, « l’aura épileptique »joue un rôle important, structure le roman d’un médecin sur un autre médecin et représente le point nodal du projet de roman qui superpose des temps et des lieux étrangers, loin très loin l’un de l’autre 53. Le roman entremêle plusieurs trames. L’histoire de Christine et des deux hommes de sa vie et parallèlement l’histoire de Beausang, de Zimara (nom d’un philosophe averroïste de Padoue), de Chigi (famille Chigi) et de Renata Belmissieri. Tous ces personnages sont reliés par le livre (2 pôles : Christine et le livre) et par l’écriture : journal, manuscrit, thèse, lettres, contrefaçons, la Bible et, notamment, le Cantique des cantiques, l’Antiphonaire, tout écrit est englobé dans ce roman à la structure ouverte, baroque, foisonnante et à l’érudition touffue et troublante. Tout est livre.
Ėcrit à l’ombre de Eco et de Joyce, ce roman nous plonge dans deux époques : la civilisation nord-américaine contemporaine, ses courses folles, ses voitures et ses motels et la Renaissance en Italie du Nord, en Suisse et en France (notamment Lyon), dans les milieux des médecins et de l’édition. Aquin s’amuse à multiplier les pistes à « ensevelir le lecteur sous une multitude de notations, historiques, médicales et autres ».
Il devient lui-même un « abyme de science », un nouvel humaniste, sorte de réincarnation de Pic de la Mirandole ou de Paracelse (modèles de son héros qui doit toutefois son prénom à Scaliger). Noms, genres littéraires, citations intertextuelles directes et indirectes, termes médicaux, métalangage théologique, scientifique,littéraire, échafaudages historiques, lieux… se multiplient et se greffent dans le corps démesuré, ouvert de ce grand fleuve romanesque. Mais tout cet apparat historique, érudit n’est pas évidemment accumulé en désordre.
Cette accumulation devient signifiante, exactement comme chez Rabelais, où les accumulations traduisent un au-delà de la parole. Les mots sont des choses, des « paroles présentes». L’auteur prend ainsi possession du monde. Par l’accumulation, par la prolifération des mots, mais aussi des genres romanesques (roman historique, roman intime, roman policier, Thèse …). Aquin évoque l’image d’une Renaissance où le savoir, grâce à l’imprimerie et aux nouvelles découvertes s’élargit et devient presque insaisissable. Agrippa, Fracastor, Paracelse deviennent les héros d’un monde en évolution que l’auteur sonde et intègre dans le tissu narratif. Ce brouillage des lieux et des temps, typique d’Hubert Aquin (cf. Prochain Episode où l’intrigue policière se déroule en Suisse et au Québec entre folles courses, agents secrets et mystères…) est complexe et savamment structuré. On y retrouve :
- 4 narrateurs ;
- 2 niveaux diégétiques :
- D1 récit autobiographique avec le narrateur homodiégétique ;
- D2 récit historique intradiégétique avec le narrateur hétérodiégétique ;
- DO passages atemporels (réflexions philosophiques et médicales de Christine) ;
- 18 genres narratifs (roman historique, policier, érotique, thèse, Bible, discours médical, autobiogrpahie…) ;
45 chapitres ou sections formant diverses séries narratives.
Un savant « brouillage », des structures complexes créent chez le lecteur ébloui un imboglio de perceptions diverses, de jeux de miroirs entre ces aventures et entre la vie de Christine et celle de son double Renata Belmissieri, jeune fille épileptique qui vit en faisant de la contrebande de manuscrits, entre la Suisse et l’Italie. Elle se rend à Chivasso chez Zimara pour livrer le manuscrit de Beausang. L’imprimeur la viole pendant une crise et sa femme Antonella le tue. Elles trouvent enfin refuge chez Chigi. Nouvelle violence sur Renata qui, dénoncée par Antonella, sera pendue. Chigi et Antonella vont en Suisse où Chigi assume l’identité de Beausang et écrit des faux. Antonella mène une vie débauchée et Chigi la tue après l’avoir surprise avec son amant. Il s’enfuit à Lyon où il travaille chez les imprimeurs et meurt de syphilis.
Les rapprochements entre les deux époques, entre la destinée de Christine (violée et battue comme Renata) tissent un réseau de liens qui identifient peu à peu les personnages à leur double (Paracelse pour Aquin est son double, cf. p. XLV et bib. n. 73). Ce procédé abolit les frontières du temps. Il tend à nous faire percevoir le récit comme s’il se composait d’une seule trame dramatique. Le lecteur est pris par ces feux d’artifice du langage et de l’érudition, par le cheminement intérieur des personnages, chacun se prolongeant dans son double
Christine contemplait longuement, parfois, ce paysage infini - série vincienne de plages, de prés, d’encoches, de bras de mers amputés … elle contemplait la hanche écorchée de la côte californienne. (p. 10-11)
'Je' troublé et troublant
Je ne tourne pas quand je tombe, mais – oh, boy… - je tombe bêtement sans prévenir, sur las carreaux, dans les escaliers, à San Diego et même sur le chemin vicinal entre Novara et Chivasso, ville absolue (cita absoluta) vers laquelle je me dirige, pas à pas porteuse artisanale d’un manuscrit précieux dont j’ai pris livraison à la frontière suisse et qu’un imprimeur de Chivasso attend avec angoisse pour l’imprimer (il s’agit du manuscrit du « Traité des maladies nouvelles » de Jules-César Beausang). Mon nom est Renata Belmissieri (p. 28).
Oh, pauvre moi, pauvre Christine, pauvre Renata, pauvre Christine, pauvre Beausang… (p. 65)
On assiste à une métaphorisation du « je » de l’énonciation (cf. Mélançon pour Prochain Episode) : par un même signifiant 'je' le texte renvoie à deux référents différents : Christine et Renata. Le texte est seulement apparemment incohérent. C’est au lecteur de reconstruire la cohérence textuelle en transportant la deixis d’un niveau diégétique à l’autre. Il s’agit donc d’une métaphorisation qui ne porte pas sur le sens sémantique mais sur le référent.54 L’emboîtement de deux époques, de lieux divers et de sensations parallèles plonge le lecteur dans une multiplicité de perceptions concentriques qui entourent les personnages et les révèlent comme au travers d’un prisme ou des projections kaléidoscopiques que constituent les rapports entre la Renaissance et le XXe siècle. Ces plongées, ces allées-retours intègrent et synthétisent deux univers distants mais très semblables par leur rapidité, l’accumulation d’éléments hétéroclites, la multitude des informations, le désir de connaître, l’accumulation des savoirs et le pluralisme de la pensée et de la violence. Surimpression du présent sur le passé, vaste collage ce roman (40% sur le XVIe siècle, le reste consacré à la vie de Christine : personnage central (elle doti son nom au Christ), qui après avoir assisté à la mort de presque tous les personnages mettra fin à sa vie) est « percutant, singulier, fascinant, mystérieux, violent… une œuvre sublime, maudite, épurante, purificatrice, baroque, subversive… elle ressemble à Hubert Aquin » (Martel, La presse, 29 nov. 1969, p. XLIII), romancier maudit et terroriste québécois.
La violence et les actes répétés de violence physique et psychologique ont été lus comme une représentaion de la situation du Québec dans les années ‘60. La critique psychanalytique a aussi identifié le Canada avec le père et la France avec la mère :
Le Québec ne peut se penser ni se raconter qu’en tant que réalité mythique. Totalité imaginaire désincarnée de l’historique, que le romancier se verra inapte à en rendre compte sur le mode réaliste, de l’écriture comme un référent concret reconnaissable. … En ce sens le romancier québécois sera amené … à traduire l’objet social en un langage fondamentalement subjectif, esthétique. Il se cherchera des alibis dans une écriture métaphorique, car le Québec n’est pour lui perceptible que comme métaphore précisément : il n’existe que par analogie. Et ne trouve de consistance que dans et par la littérature. 55
Le lecteur se trouve donc dans l’impossibilité de s’abandonner au pacte de lecture. Cette perspective dans un roman que l’on peut qualifier en partie d’historique met en question les pratiques historiographiques. L’histoire est abolie dans un mouvement circulaire indéfini de l’antiphonaire sur lui-même. Joyce et Aquin : entr’eux un miroir et le fantasme de l’exhaustivité :
L’ensemble du roman devra prendre l’allure d’une synthèse sans fin. L’auteur reste une sorte de marin qui se guide tant sur les constellations célestes que sur l’astrolabe qu’il tient entre les mains. (Plan) (p. XLVIII )
Tous ces auteurs sont des marins qui remontent vers le passé comme le marin regarde le ciel étoilé, pour trouver leur chemin dans le chaos de l’existence, dans l’océan de la solitude.
Bibliographie
Michel Del Castillo
Site : http://www.micheldelcastillo.com
W. DINKELMAN, La représentation de l’ histoire chez Michel Del Castillo, Berne, Berlin, Paris, P. Lang, 1992.
F. DORENLOT, Michel Del Castillo, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1992.
F. DORENLOT, «La revanche du malheur : Michel del Castillo», Dalhousie French Studies, n. 19, 1990, pp. 67-83 ;
M. GAZIER, «Michel del Castillo. L’écriture, c’est la vie», Etudes, janvier 2001, pp. 93-101.
Entretien de Michel del Castillo avec Francine Bordeleau, « Michel del Castillo. Pour échapper à sa biographie», Nuit Blanche, n. 81, hiver 2000-2001.
Marguerite Yourcenar
B. ARANCIBA, «Infraction du tabou : l’inceste dans Anna, Soror…», in Le sacré dans l’œuvre de M. Yourcenar, Tours, SIEY, 1993, pp. 269-277.
L. BRIGNOLI, «La couleur du péché: le clair et l'obscur dans Anna, soror...», in Il Confronto Letterario, VIII, 1991, pp. 175-182.
B. DEPREZ, «Anna, soror…ou la perfection de l’inceste », in M. Yourcenar. Ecriture, maternité, démiurgie, Berne, Berlin, Paris, Peter Lang, 2003.
M. DUPUIS, « Du Remous à l’écoulement : la genèse d’Anna, soror…», in Roman, histoire et mythe dansl’œuvre de M. Yourcenar, Tours, SIEY, 1995, pp. 141-154.
M. GANTREL, «Anna, soror… ou le plaisir du texte», Bulletin, n. 17, Tours, SIEY, 1996.
M. C. POIX-TETU, Le Discours de la variante. Approche sémiotique de la genèse d’Anna Soror de M. Yourcenar, Paris-Turin, L’Harmattan, 2001.
T. SANZ, «Anna, soror… ou l’exil intérieur», in Écritures de l’exil, p. 137
G. TOSCANO, «Espaces sacrés. Espaces profanes dans Anna, Soror…», in C. FAVERZANI (dir.), M. Yourcenar et la Méditerranée, Littératures, Clermont-Ferrand, 1995.
M. YOURCENAR, Le temps ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 1983.
M.-J. VAZQUEZ DE PARGA, «Erotisme sacré, Anna, soror…», in R. POIGNAULT, M. GOSLAR, Le sacré dans l’œuvre de M. Yourcenar, Tours, SIEY, 1993, pp. 279-290.
Hubert Aquin
A. E. CLICHE, Le désir du roman : Hubert Aquin, Réjean Ducharme, Montréal, XYZ, 1992.
D. DE LAET, L'Antiphonaire d'HubertAquin et le symbolisme alchimique, University of Calgary Theses, 1986.
R. DUBOIS, Hubert Aquin blues : essai, Montréal, Boréal, 2003.
A. LAMONTAGNE, Les mots des autres : la poétique intertextuelle des oeuvres romanesques de Hubert Aquin, Québec, Presses de l'Université Laval, 1992.
A. SORON, Hubert Aquin ou la révolte impossible, Paris, L'Harmattan, 2001.
R. MELANCON, «Le téléviseur vide ou comment lire L’Antiphonaire », Voix et images, n.3, 1977, pp. 244-264.
F. IQBAL, H. Aquin romancier, Québec, Presses de l’Université de Laval, 1978.
R. LAPIERRE, L’Imaginaire captif. Hubert Aquin, Montréal, Quinze, 1981.
L. NISSIM, «L’Antiphonaire d’Hubert Aquin ou l’Altérité problématique», in Carla FRATTA (dir.), L’Altérité dans la littérature québécoise, Bologne, CLUEB, 1987, pp. 173-209.
L. NISSIM, «L’Antiphonaire di Hubert Aquin o la proliferazione del doppio», Africa America Asia Australia, n. 3, 1987, pp.105-131.
R. RICHARD, Le Corps logique de la fiction. Le romanesque chez H. Aquin, Montréal, L’Hexagone, 1990.
A. WALL, H. Aquin entre référence et métaphore, Montréal, Les Editions Balzac, 1991.
Note
↑ 1 E. Wiesel, Paroles d’étranger, Paris, Le Seuil, 1982, pp. 7, 11-12, 14.
↑ 2 Marianne Payot, « Michel del Castillo », Lire, octobre 1995.
↑ 3 Michel del Castillo, De père français, Paris, Fayard, 1998, p. 13.
↑ 4 Pour une liste assez exhaustive de ces auteurs, voir A. Brincourt,Langue française, terre d’accueil, Paris, Ėditions du Rocher, 1997 ; D. Combe,«Le changement de langue», in Poétique francophone, Paris, Hachette, 1995, p. 105 sq. Voir aussi Emanuela Cavicchi, Esilio, cambiamento linguistico e scrittura in alcuni autori europei contemporanei. Un caso paradigmatico: le favole nere di Agota Kristof, Université de Ferrare, a.a. 2000-2001 et le livre récent de T. Miletic, European Literary Immigration into the French Language. Readings of Gary, Kristof, Kundera and Semprun, Amsterdam / New York, Rodopi, 2008.
↑ 5 Cf. sur ce phénomène M. Bornand, «Agota Kristof, une écriture de l’exil», R.I.T.M., n. 12, 1996, p. 133-134 et J. E. Jackson, «L’ écriture comme traduction», Revue de littérature comparée, n.273, 1, 1995.
↑ 6 Sur la notion de double bind et de “passé contraignant” voir l’ouvrage de Michèle Bacholle, Un passé contraignant. Double bind et transculturation, Amsterdam, Rodopi, 2000, consacré notamment à trois écrivains (Annie Ernaux, Agota Kristof, Farida Belghoul) qui offrent une approche paradigmatique de leur passé, marqué par la “double contrainte” ou double bind.
↑ 7 Cf. Exilés, marginaux et parias dans les littératures francophones, Actes du Colloque International, Brock University, Octobre 1992, Textes réunis et publiés par S. L. Beckett, L. Boldt-Irons et A. Baudot, Toronto, Éditions du GREF, 1994, p. 6.
↑ 8 Michel Del Castillo, De père français, Paris, Fayard, 1998. Sur l’œuvre de M. Del Castillo, voir: F. E. Dorenlot, Michel Del Castillo, Dinkelmann La représentation de l’histoire chez Michel Del Castillo: La nuit du décret, La gloire de Dina, Le démon de l’oubli, Berne-Berlin-Paris, P. Lang, 1992.
↑ 9 Michel Del Castillo, Le crime des pères, Paris, Ėditions du Seuil, 1993, p. 11. Dans Rue des Archives, Paris, Gallimard, 1994, p. 169 il révèle toutefois l’aspect ironiquement “espagnol” de cette déclaration. Voir aussi sur ses origines espagnoles l’article M. Del Castillo, «Je suis un musulman», paru dans Le Monde, vendredi 18 janvier 2002, p. 15.
↑ 10 J. Perrignon, «Mon père, ce zéro, Interview à Michel del Castillo», Libération, le 27 mai 1998.
↑ 11 M. Payot, «Interview à Michel del Castillo», Lire, octobre 1995.
↑ 12 M. Del Castillo, Adieu au siècle, Paris, Ed. du Seuil, 2000.
↑ 13 Cf. M. Del Castillo, Colette. Une certaine France, Paris, Stock, 1999. Prix Femina essai 1999. Dans Les étoiles froides, Paris, Editions Stock, 2001, encore une fois la mère infâme et monstrueuse resurgit, sous les traits de Clara del Monte, avec tout son pouvoir d’attraction maléfique, ses mensonges, ses trahisons infinies. Cf. J.-P. Tison, «Michel del Castillo, “Les étoiles froides”», in Lire, octobre 2001.
↑ 14 Brincourt, Op. cit., p. 238.
↑ 15 Payot, Op. cit.
↑ 16 Voir la nouvelle préface que M. Del Castillo a écrit pour Tanguy. Histoire d’un enfant d’aujourd’hui, Nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Gallimard, « Folio », 1995, pp. 9-28.
↑ 17 M. Del Castillo, Rue des Archives, Paris, Gallimard, 1994, p. 13.
↑ 18 M. Del Castillo, La Madre assente, trad. Antonella Raspi, Firenze, Le Lettere, 1999.
↑ 19 Brincourt, Op. cit., p. 239.
↑ 20 Javier est l’un des vrais prénoms de Miguel Javier del Castillo, cf. Dorenlot, Op. cit., passim.
↑ 21 Paris, Gallimard, 1997. Cf. F. Dorenlot, «La Tunique d'infamie by Michel del Castillo», The French Review, vol. 72, n. 2 ( déc. 1998), p. 362 sq.
↑ 22 Paris, Fayard, 2006.
↑ 23 Cf. son Dictionnaire amoureux de l’Espagne, Paris, Plon, 2005. « Alors que Tanguy, son premier et inoubliable roman, se prépare à fêter son demi-siècle sans avoir pris l'ombre d'une ride, Michel del Castillo poursuit, hors des modes, son rigoureux chemin en littérature. Explorant sans cesse les mêmes visages et les mêmes paysages, où se mêlent et s'affrontent l’histoire de l'Espagne et sa propre histoire, il compose une œuvre musicale dans laquelle romans, récits, pièces de théâtre, essais et aujourd'hui dictionnaire sont autant de variations sur le thème de l'identité. Au-delà du mystère des origines - celui d'une mère espagnole qui l'a un jour abandonné aux fureurs de la guerre -, Castillo s'attache à analyser les mystères de l'Espagne. Ce Dictionnaire amoureux est une belle occasion pour lui de revisiter ses obsessions, ses amours et ses haines... L'Espagne qu'aime Castillo est celle des créateurs, des marginaux, des réprouvés, de ceux qui crient leur désir de liberté quand tous moutonnent, têtes basses. Il y a des Espagne, nous dit Castillo, faisant écho au poète Antonio Machado qui écrivait, s'adressant à son lecteur espagnol, son frère : «L'une de ces [...] Espagne te gèlera le cœur.»
↑ 24 C’est la le passage que Del Castillo a choisi pour la “ quatrième” de couverture de son livre.
↑ 25 Sur cette dialectique Mémoire/Oubli, cf. W. Dinkelmann, La représentation de l’histoire chez Michel Del Castillo: La nuit du décret, La gloire de Dina, Le démon de l’oubli, Op. cit., passim. L’auteur relève l’importance de l’intertexte: Bernanos (mal, culpabilitè) ; Ortega y Gasset ; Unanumo.
↑ 26 Cf. aussi p. 195, c’est Gonzalvo qui lui a « passé » ce roman.
↑ 27 Sur le « vrai » Manrique, cf. J. Contreras, Pouvoir et Inquisition en Espagne au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1997. Un autre roman sur l’Inquisition est celui de Arturo Pérez-Reverte, La peau du tambour, Paris, Seuil, 1997.
↑ 28 L'ascétique Manrique s'interroge sur le sens de ses renoncements. Le masque de l’ordre dont se pare l’inquisiteur se fendille là où le désir s’insinue. L'objet de sa passion s’appelle Gonzalvo de Sandoval, bretteur, buveur, dragueur, délicieux voyou aux hanches minces. Ce fils de famille consume sa vie par désespoir. Manrique brûle d'amour, mais à l'heure des comptes il hurle sa douleur de ne pas avoir su répondre au muet appel de son ami: «En vérité, j'ai été l'homme d'un unique désordre et je reste fidèle à ce délire-là, de même que Gonzalvo demeura fidèle au chaos de son impuissance. »
↑ 29 C’est le titre du roman de Del Castillo, La vie mentie, Paris, Fayard, 2006 : « Tout réussit à Salvador Portal, ancien soixante-huitard devenu coach d’hommes d’affaires. Il mène, dans son loft de la Bastille, l’existence confortable des bobos. Un malaise insidieux pourtant le ronge, et il s’enfonce dans l’alcoolisme. Au fil des confidences de Véra, sa grand-mère, qui a choisi de se reclure en France dans une maison de retraite et de son père, Gonzalo, il mesure à quel point il marche à côté de sa vraie vie. Née à Berlin de parents juifs assimilés, Véra a suivi en Espagne Rafael Portal, jeune universitaire spécialiste de la culture arabo-andalouse et disciple de Miguel de Unamuno, échappant ainsi au piège de l’Allemagne nazie. Avec son mari, tué en 1936 dans des circonstances tragiques, elle a vécu un amour passionné, et ce grand-père de légende hante la mémoire familiale. A l’annonce du suicide de son père, Salvador se décide enfin à se rendre en Espagne, poursuivant l’ombre d’Unamuno, figure écartelée d’une vérité sans certitudes ni raisons. Roman empoignant tout un siècle d’histoire, cette Vie mentie en condense toutes les tricheries, depuis celles des assassins de la République espagnole, pas tous phalangistes, jusqu’aux pseudo-révolutionnaires des années 60, manipulateurs troquant leurs services, leurs titres et leurs slogans contre des matelas de stock-options. Traversant cette symphonie familiale, la digne et ferme figure de Véra à qui son petit-fils ne pourra qu’avouer finalement : Tu n’as eu besoin de rien faire ni dire pour me sauver de la désintégration ; il t’a suffi d’être toi-même. "Je ne possédais aucune vérité, je n’en aurais jamais aucune, mais je savais désormais où elle se situait, loin, très loin, dans un ailleurs inaccessible. Je savais que l’important n’est pas ce qu’on possède mais ce qu’on cherche. »
↑ 30 Sur la « vraie » Ana d’Autriche, cf. M. Formica, La Fille de Don Juan d’Autiche, Ana de Jésus dans leprocèsintenté au pâtissier de Madrigal, Madrid, « Revista de Occidente », 1973. Cf. aussi ID., Maria de Mendoza(Solution d’une énigme historique), Madrid, 1979.
↑ 31 “Dans cette histoire, je trouvais par ailleurs une interrogation sur l’identité, thème, mes lecteurs le savent, qui traverse tous mes livres ou presque” (p. 12). Le mot « identité » revient comme un refrain : p. 21, jeu sur l’identité d’Ana et de son amoureux, jeux de noms, secrets et mystères qui entourent Sébastien/le pâtissier ; p. 61, elle devine l’identité de son père ; p. 177, « véritable identité » de Gabriel ; p. 212, aveu de l’ identité de Gabriel ; p. 217, bâtardise ; p. 253 « véritable identité de son amant » ; p. 269, « l’ énigme de l’identité de Gabriel d’Espinosa ».
↑ 32 Cf. aussi p. 85 : « C’est ici que ma défiance vis-à-vis du roman historique se manifeste… » ; p. 163, sur les ambiguïtés du roman historique.
↑ 33 Cf. pour ce bouquet d’adelfas : « j’ai souvent imaginé qu’Ana contemplait avec douceur les adelfas d’où ce livre est sorti », p. 78 ; p. 79 ; p. 95, « même les adelfas baissaient la tête, assommés » ; p. 128, « regardait les adelfas « ; p. 179, « Gabriel et les adelfas – elles se redressent, comme la vie de Ana » ; p. 301, « force de regarder les adelfas »p. 309 ; p. 311.
↑ 34 Cf. p. 38 où il est question de la Bible de Valentine ayant appartenu à l’ « un de leurs parents napolitains, gagné à l’évangélisme .. avant de passer à Bâle ou en Angleterre ». Le modèle de Valentine est, selon certains critiques, Elisabeth de Hongrie (cf. DUPUIS, p. 150).
↑ 35 Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent ! quis nouus hic nostris successit sedibus hospes, quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis! credo equidem, nec uana fides, genus esse deorum. degeneres animos timor arguit. heu, quibus ille iactatus fatis! quae bella exhausta canebat! si mihi non animo fixum immotumque sederet ne cui me uinclo uellem sociare iugali, postquam primus amor deceptam morte fefellit; si non pertaesum thalami taedaeque fuisset, huic uni forsan potui succumbere culpae. Anna (fatebor enim) miseri post fata Sychaei coniugis et sparsos fraterna caede penatis solus hic inflexit sensus animumque labantem impulit. agnosco ueteris uestigia flammae. sed mihi uel tellus optem prius ima dehiscat uel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras, pallentis umbras Erebo noctemque profundam, ante, pudor, quam te uiolo aut tua iura resoluo. ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores abstulit; ille habeat secum seruetque sepulcro.' sic effata sinum lacrimis impleuit obortis. (Aen., IV, 9-30) Cf. aussi le premiers mots de l’épitaphe que Anna a fait graver sur le tombeau de son frère.
↑ 36 M. Bordin parle à propos de Lucrezia Borgia et du roman de Bellonci de : “condivisione esistenziale tra soggetto scrivente e materia”, “osmosi tra narratore e personaggio”. Les objets ont ici aussi une valeur métonymique, comme par exemple les pantoufles d’Ana, objet du désir amoureux
↑ 37 Cf. maintenant sur la genèsede Anna soror… le livre de M. C. Poix-Têtu, Le Discours de la variante. Approche sémiotique de la genèse d’Anna Soror de M. Yourcenar, Paris-Turin, L’Harmattan, 2001.
↑ 38 La couverture de l’édition Folio (1991) qui représente le tableau de El Greco, Femme à la fourrure transmet un message iconique. Elle évoque le « faire compulsif et tremblé du grand peintre de Toledo » qui convient si bien à ce récit (cf. p. 96).
↑ 39 Cf. p. 38 où Miguel découvre dans la Bible le passage des “Rois où il est question de la violence faite par Amnon à sa sœur Thamar ». Cf. 2 Sam13, 6-22 : « Le roi vint le voir et Amnon dit au roi : "Permets que ma sœur Tamar vienne confectionner sous mes yeux deux crêpes, qu'elle me les apporte, et je mangerai ." David envoya dire à Tamar chez elle: "Va donc chez ton frère Amnon et apprête-lui de la nourriture." Tamar s'en alla chez son frère Amnon. Il était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, confectionna les crêpes sous ses yeux, et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et la vida devant lui, mais il refusa de manger. Amnon dit : "Faites sortir tout le monde d'ici." Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent. Amnon dit à Tamar : "Apporte la nourriture dans la chambre, donne-la moi et je mangerai." Tamar prit les crêpes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans la chambre. Elle lui présenta à manger. Il la saisit et lui dit : "Viens, couche avec moi, ma sœur !" Elle lui dit : "Non, mon frère, ne me violente pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte ? Et toi, tu serais tenu en Israël pour un infâme. Parle donc au roi. Il ne t'interdira pas de m'épouser." Mais il ne voulut pas l'écouter. Il la maîtrisa, lui fit violence et coucha avec elle. Amnon se mit alors à la haïr violemment. Oui, la haine qu'il lui porta fut plus violente que l'amour qu'il avait eu pour elle. Amnon lui dit : "Lève-toi. Va t'en !" Elle lui dit : "Non, car me renvoyer serait un mal plus grand que l'autre, celui que tu m'as déjà fait." Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : "Qu'on expulse cette fille de chez moi, et verrouille la porte derrière elle !" Elle portait une tunique princière, car c'est ainsi que s'habillaient les filles du roi quand elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et verrouilla la porte derrière elle. Tamar prit de la cendre et s'en couvrit la tête, déchira sa tunique princière, se mit la main sur la tête et partit en criant. Son frère Absalom lui dit : "Est-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. N'y pense plus. » Tamar demeura donc, abandonnée, dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit toute cette affaire et en fut très irrité. Absalom ne dit plus un mot à son frère Amnon, car Absalom avait pris Amnon en haine, à cause du viol de sa sœur Tamar.La Bible de Valentine réapparaît, p. 48 et p. 54, quand Anna reprend la Bible après le cri : « Amnon, Amnon, frère de Thamar. »
↑ 40 Elle cite ; J. Ford, Byron, Montesquieu, Chateaubriand, Goethe, Th. Mann, R. Martin du Gard.
↑ 41 Cf. Ovide, Metamorphoses, IX, 446-665.
↑ 42 Cf. Infraction du tabou, p. 273.
↑ 43 Cf. aussi, p. 25 : « ce visage si semblable au sien qu’il crut voir son propre reflet au fond d’un miroir » ; « couple gémellaire », « androgyne primitif ». Cf. M. Gantrel et T. Sanz, Op. cit., passim.
↑ 44 Cf. Erotisme sacré, p. 287.
↑ 45 Dans D’après Gréco, titres précis. Cf. Dupuis, p. 147.
↑ 46 Cf. sur cette épitapheM. C. Poix-Têtu, Le Discours de la variante. Approche sémiotique de la genèse d’Anna Soror de M. Yourcenar, Op. cit., p. 55.
↑ 47 Ibidem, p. 174.
↑ 48 Idem.
↑ 49 Cf. G. Zarri, La religione di Lucrezia Borgia. Le lettere inedite del confessore, Roma, 2006.
↑ 50 B. GELAS, Le traitement de la fiction dans les œuvres romanesques de Marguerite Yourcenar in Marguerite Yourcenar, une écriture de la mémoire, Sud, 1990, p. 13.
↑ 51 H. Aquin, L’Antiphonaire, Montréal, Le Cercle du livre de France, 1969. Cf. maintenant l’édition critique. L’antiphonaire, édition critique établie par Gilles Thérien, Montréal, Bibliothèque Québécoise, 1993.
↑ 52 Cf. A. Wall, p. 131 parle de mouvement chronotypique, de « profonde instabilité spatio-temporelle, va-et-vient dans le temps et dans l’espace qui ne s’arrête qu’avec le dernier mot du roman. »
↑ 53 Influence du Dr. Penfield.
↑ 54 Cf. sur la métaphore chez Aquin, A. Giaufret, H. Aquin romanziere : per un’analisi della metafora, Thèse de doctorat, Université de Bologne, a.a. 1993/1994.
↑ 55 J. Kwaterko, Le roman québécois de 1960 à 1975. Idéologie er représentation littéraire, Montréal, Edidions du Préambule, 1989, p. 16.